Voilà la question que je me suis désespérément posée après le discours des jeunes diplômés d’AgroParisTech en mai 2022. Un an est passé, et après avoir multiplié les expériences académiques, professionnelles et associatives, je crois pouvoir enfin esquisser les contours d’une réponse.
Revenons quelques années en arrière. J’ai commencé à me poser sérieusement des questions sur l’impact de mon futur métier en 2020, après quatre ans d’études d’ingénieur. Plutôt concerné par la transition écologique, mais encore assez ignorant des blocages qui existent, je prends un an de césure où je pars en stage dans une entreprise qui développe des projets d’énergie renouvelable. En tant que chef de projet éolien, je suis surtout sur le terrain, à essayer de convaincre les citoyens de signer des engagements contractuels pour faire avancer les projets. Positionné en aval de la chaîne énergétique, je réalise alors bien rapidement les limites d’un modèle de déploiement des EnR non planifié par l’Etat, consistant à laisser les entreprises privées se concurrencer entre elles au point que les maires et propriétaires en zones rurales ne savent plus où donner de la tête. Pendant les réunions internes auxquelles j’assiste, je suis forcément déçu de comprendre que la motivation principale de l’entreprise qui m’emploie est de maximiser des profits (la fin) et que la production d’électricité renouvelable n’est qu’un moyen pour y parvenir. Cette première expérience aura eu le mérite de me faire comprendre que la situation n’est pas binaire… Il est certain que travailler dans les EnR est climatiquement plus positif que dans les énergies fossiles… mais est-ce suffisant ? Changer la manière de produire de l’énergie est une chose, réduire notre consommation et notre ultra dépendance en est une autre… et c’est bien sur ce deuxième point qu’il me semble particulièrement urgent d’agir.
L’année suivante, au lieu de réaliser ma cinquième et dernière année au sein de mon école d’ingénieur, je rejoins un master d’économie spécialisé dans les énergies. En dépassant mon statut initial d’ingénieur, l’idée est d’appréhender les logiques qui régissent le fonctionnement de notre modèle économique. Cette alternance, je la décroche au sein du Groupe Crédit Agricole pour travailler sur le financement d’unités de Biogaz et de Biométhane. C’est peut-être idéaliste et ambitieux, mais ma décision est alors motivée par l’idée d’aller “au cœur du réacteur” pour “faire bouger les lignes”. Les raisons de cet aveuglement naïf doivent peut-être être cherchées du côté des discours que j’ai commencé à entendre lorsque je me suis mis à questionner le sens de mes études. Professeurs, anciens élèves de l’école ou membres de ma famille, tous me répètent que la meilleure chose à faire est d’aller “changer les choses de l’intérieur”. En prenant ce poste au siège d’un grand groupe bancaire, j’ai le sentiment de ne pas pouvoir aller plus “à l’intérieur”. Je suis à l’amont de la chaîne énergétique : là où les décisions de financement sont prises.
« Changer les choses de l’intérieur » : changer quoi exactement ?
D’abord, pour changer quoi que ce soit, il faut que je m’intègre, et au siège d’une grande banque, cela veut dire mettre des chemises bleues, des chaussures en cuir, et faire une croix sur toute profondeur d’interactions sociales. Ce côté très “fade” des relations humaines m’a tellement marqué que j’en ai fait un texte, publié sur LinkedIn puis sur Le Monde, ce qui m’a valu un grand nombre de messages adorables de la part de personnes ayant ressenti le même vide humain dans des cadres de travail similaires.
Mes missions étaient consacrées à l’analyse technico-économique d’unités de biogaz, mais j’assistais également aux réunions d’équipes mensuelles dans lesquelles on fait le bilan sur le portefeuille de projets et l’atteinte des objectifs. Ma participation à ces réunions a grandement contribué à me faire comprendre “l’état d’esprit” qui règne dans le milieu bancaire. On y parlait que de chiffres, tout était quantifié, mesuré, de manière à ce qu’on puisse faire de grands tableaux de suivis récapitulant les ratios économiques, le taux de satisfaction client, et même des choses plus abstraites comme “l’indice d’excellence relationnelle”. Les objectifs du département ne se calculent ni en MW de capacité installée, ni en MW/h d’électricité produite mais en Millions d’Euros d’Investissement et en % de rentabilité. C’est bien clair, encore une fois, le financement des énergies renouvelables n’est qu’un moyen, la finalité du groupe qui m’emploie reste toujours la même : engranger du profit. Si l’histoire s’arrêtait là, on pourrait se dire que ce n’est pas si problématique, que l’impact de mon travail est relativement positif. Le problème est de savoir à quoi servent les profits générés par le département auquel j’appartiens. En l’occurrence, le Crédit Agricole est le premier financeur du groupe TotalEnergies, entreprise dont 70% des investissements sont encore dédiés aux énergies fossiles. De 2016 à 2021, ce soutien a représenté plus de 7 milliards d’euros et Amundi, l’une des filiales du Crédit Agricole, en est le premier actionnaire. En tant que salarié, cette hypocrisie était assez insoutenable. D’un côté j’œuvrais pour la transition énergétique en France, de l’autre, les profits générés par mon activité permettaient, indirectement, de financer des bombes climatiques comme le projet EACOP, qui est à l’origine du déplacement de plus de 100 000 personnes vivant à proximité du projet en Tanzanie et en Ouganda et qui devrait émettre plus de 34 millions de tonnes de Co2 dans l’atmosphère par an.
Si bifurquer est la seule solution, où faut-il aller ?
Mes différentes tentatives me font toutes arriver à la même conclusion : c’est bien l’état d’esprit de “quête de profit” qu’il faut bousculer. Or cette recherche de rentabilité est la raison d’être d’une entreprise… Essayer de changer ce paradigme en travaillant à l’intérieur d’une banque semble voué à l’échec, à moins que l’entreprise ne veuille se mettre elle-même en difficulté. Le Crédit Agricole, comme ses concurrents, n’est pas la seule entreprise fautive. Toutes sont prises dans une mécanique infernale et n’ont donc aucun intérêt (autre qu’une certaine dignité, mais cela semble insuffisant dans le monde des affaires) à arrêter volontairement le financement des énergies fossiles. Si elles le font, elles se privent d’une source importante de profit, s’affaiblissent face à leurs concurrentes, et prennent le risque d’être rachetées par eux. Ainsi, la question se pose à l’échelle de la société : quel modèle économique juste et durable permettrait aux entreprises de sortir de cette infinie quête de croissance ?
Pour beaucoup d’ingénieurs (mais pas que), le débat d’idées sur la décroissance est devenu une réelle source d’espoir, un refuge idéologique, où pour la première fois, je trouvais une approche systémique à la hauteur de l’urgence climatique. À partir du constat que le modèle économique actuel est incapable de résoudre une crise si profonde qu’il a lui-même provoquée, la décroissance permet de penser un modèle de société prenant en compte la finitude des ressources planétaires, dans un esprit de démocratie et de justice sociale. Le plus impressionnant est de voir que des auteurs comme André Gorz, Ivan Illich, Karl Polanyi ou Nicholas Georgescu-Roegen avaient déjà compris dans les années 1970 l’absurdité du modèle actuel, avant même que le changement climatique soit compris et documenté.
Bifurquer est donc devenu évident. C’est certain, je ne travaillerai plus jamais dans une entreprise classique, encore moins un grand groupe. Mais une fois qu’on a dit ça, où aller ? Où et comment agir pour faire advenir une société de la décroissance, où la réduction de la production et de la consommation est planifiée et décidée démocratiquement, où la convivialité, l’autonomie et le soin sont les valeurs centrales ?
La coopérative, modèle central d’une économie de la décroissance
Je ne m’étais jamais trop intéressé aux coopératives mais j’en suis devenu plus familier ces derniers temps, alors que je réalisais un tour d’Europe de 4 mois avec l’association CliMates pour travailler sur les initiatives de réappropriation du pouvoir politique par les citoyens sur les questions climatiques. Le voyage (que nous avons documenté dans une série de newsletters) était axé sur un large panel de leviers citoyens comme le municipalisme, les communs, les référendums locaux ou encore les conventions citoyennes. Il m’a aussi permis de rencontrer des citoyens engagés sur des thématiques diverses. J’ai été particulièrement captivé par le fonctionnement des coopératives, sujet qui s’est révélé en résonance avec mes questionnements sur le rôle de l’ingénieur au service d’une société écologique. À Bari, Bruxelles ou Berlin, j’ai découvert des coopératives exerçant des activités dans des domaines variés comme l’énergie, le logement ou l’agriculture.

Une coopérative, c’est une entreprise qui appartient aux consommateurs. L’idée est que le citoyen puisse exercer un contrôle démocratique sur ce qu’il consomme et ce qui est produit. En principe, il faut acheter des parts d’une coopérative pour en devenir actionnaire (ou coopérateur) et obtenir un droit de vote à l’assemblée générale. Contrairement à une entreprise classique, le nombre de parts n’est pas proportionnel au nombre de voix. Si certains citoyens ont 200 parts, ces derniers auront autant d’influence sur la stratégie de l’entreprise qu’une personne qui n’en a qu’une. Ce fonctionnement est doublement pertinent : d’une part il permet aux citoyens de contrôler la production (élément sur lequel les citoyens n’ont aucun pouvoir dans le système classique), ensuite il leur permet de percevoir une partie des profits générés. La finalité d’une coopérative n’est pas censée être le profit, mais le juste partage des richesses et le développement du territoire. Les bénéfices générés doivent être réinvestis dans d’autres activités ou dans d’autres projets, par exemple en soutenant des initiatives sociales ou environnementales.
De nombreux exemples existent dans le domaine de l’énergie. À Berlin, nous avons pu rencontrer BürgerEnergie Berlin (énergie citoyenne Berlin), une coopérative qui compte 1 500 membres (propriétaires de parts) et exploite une dizaine de points de production d’énergie solaire répartis dans la ville. La marge obtenue lors de la vente de l’électricité permet à la coopérative de développer de nouveaux projets et de rémunérer ses membres. Les décisions stratégiques sont prises lors de l’assemblée générale, où chaque actionnaire dispose d’une voix, peu importe le nombre de parts qu’il possède. Au delà de la production, l’initiative plaide pour une démocratisation du secteur de l’énergie, et permet à ses membres de se sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique.
Comme avec toutes les solutions, il peut y avoir anguille sous roche. Une coopérative peut exister sous plusieurs statuts juridiques aux contours parfois flous, au point que certaines coopératives semblent très éloignées de leur idéal coopératif initial. Le Crédit Agricole, par exemple, se considère comme un groupe coopératif et mutualiste, ce qui ne l’empêche pas de continuer à financer les énergies fossiles. Du peu que j’en ai vu jusqu’à maintenant, le principal gage de sincérité d’une coopérative (dans le sens où elle est organisée démocratiquement) semble résider dans sa petite/moyenne taille et dans son implantation à l’échelle locale. En prenant ces deux éléments en compte, le modèle peut incarner une solution dans une économie où le niveau de production aurait retrouvé le “sens des limites” qui fait tant défaut à notre économie mondialisée.
Une fois passée la vertigineuse étape de la “bifurcation”, le modèle coopératif peut être une direction cohérente à emprunter, en mettant son énergie et ses compétences au service d’un collectif de citoyens qui s’auto-organisent démocratiquement plutôt que d’actionnaires déjà multimillionnaires. Dans tous les secteurs d’activités, les coopératives pourraient capter les jeunes générations en quête de sens dans leur travail pour contribuer à construire concrètement une société de la décroissance.
Photo principale : Hugo Chirol.




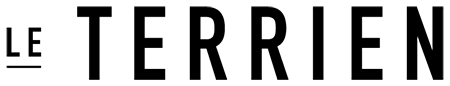
0 commentaires